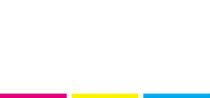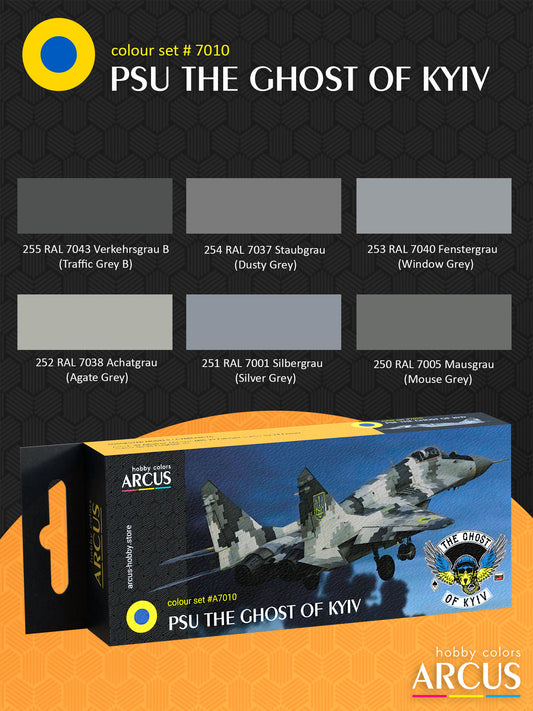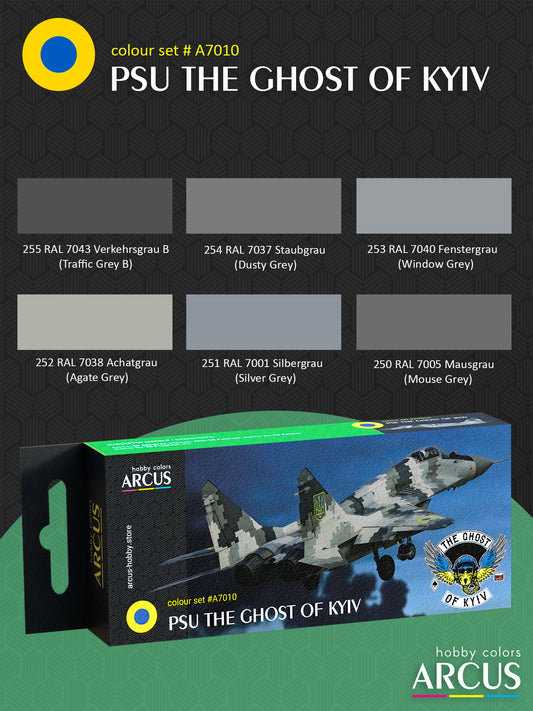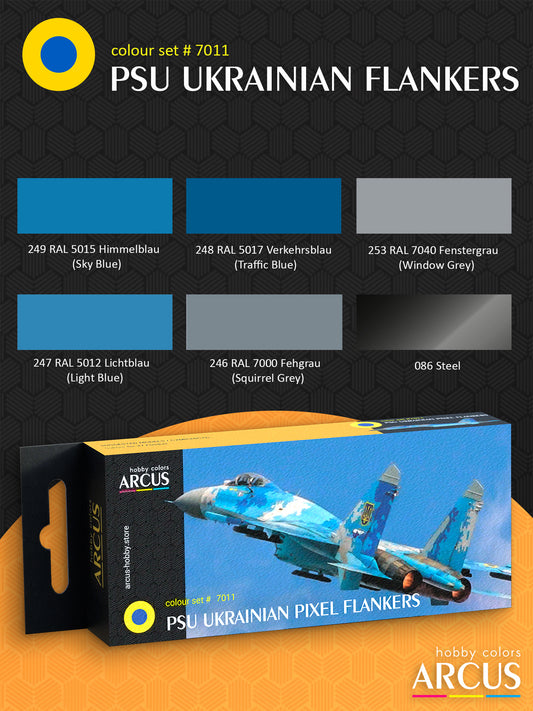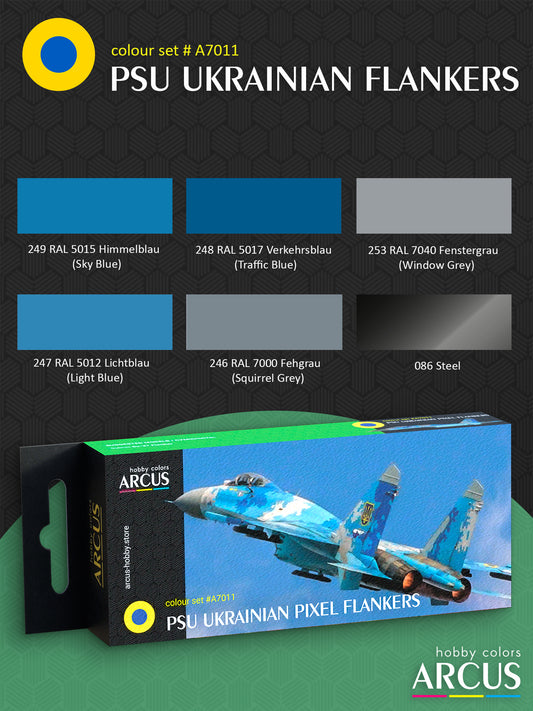À la suite de la Première Guerre mondiale, les forces armées allemandes furent dissoutes en janvier 1919. Toutefois, dès le mois de mars de la même année, le gouvernement décida de créer une nouvelle armée provisoire — le Reichswehr — destinée à servir de noyau pour les futures forces de défense. Après une période de transition de plusieurs mois, cette armée fut officiellement instituée en janvier 1921. Le traité de Versailles de 1919 imposait des restrictions sévères sur les effectifs et l’armement : l’armée allemande n’était autorisée qu’à maintenir l’ordre intérieur et à protéger les frontières. Toute possession d’armement lourd — comme l’artillerie de calibre supérieur à 105 mm, les véhicules blindés, les sous-marins ou les navires de guerre de fort tonnage — était interdite. La création d’une force aérienne était également prohibée.
Le rôle du Reichswehr dans les conflits internes
Dans les années troublées du début des années 1920, le Reichswehr fut principalement mobilisé pour réprimer les insurrections d’extrême gauche, comme le soulèvement spartakiste de janvier 1919 à Berlin, organisé par la Ligue spartakiste (Spartakusbund). Les missions de maintien de l’ordre étaient souvent confiées à des formations paramilitaires volontaires — les Freikorps — qui n’étaient pas soumises aux limitations du traité de Versailles, ou qui intervenaient dans des zones où le Reichswehr ne disposait pas de troupes formées. Cela inclut notamment des affrontements à la frontière avec des volontaires polonais et lituaniens, ainsi que des combats contre l’Armée rouge de la Ruhr (Rote Ruhrarmee), une milice ouvrière active durant l’insurrection de 1920 dans la région industrielle de la Ruhr. En octobre et novembre 1923, durant l’intervention fédérale contre les Länder de Saxe et de Thuringe (Reichsexekution), le Reichswehr collabora avec des groupes paramilitaires nationalistes pour renverser les gouvernements de gauche de ces régions. Ses généraux entretenaient des liens étroits avec des organisations de vétérans d’extrême droite, comme le Stahlhelm (« Casque d’acier ») et le Kyffhäuserbund, toutes deux hostiles à la République de Weimar.
À partir de 1921, en violation du traité de Versailles, le Reichswehr entreprit secrètement des recherches sur de nouveaux types d’armement et relança une aviation militaire en coopération avec l’Armée rouge soviétique. L’Allemagne investit dans les technologies militaires modernes et put former ses cadres en URSS.
La coopération avec l’Union soviétique s’avéra mutuellement avantageuse. L’Allemagne soutenait le développement de l’industrie militaire soviétique, tandis que des officiers soviétiques suivaient des formations dans des académies militaires allemandes. En retour, le Reichswehr obtenait un accès direct à de nouveaux équipements et organisait l’instruction de ses unités sur le sol soviétique, à l’abri des regards des puissances occidentales. Une école d’aviation conjointe fut fondée à Lipetsk, où des instructeurs allemands formèrent quelque 120 pilotes soviétiques, plus de 100 observateurs aériens et une trentaine de mécaniciens. Une partie de l’enseignement se déroulait également en Allemagne. L’objectif principal était de préparer du personnel et de tester des procédés pour une future armée de l’air allemande, en dépit des interdictions imposées par les Alliés.
L’occupation de la Ruhr par des troupes françaises et belges en 1923 constitua une grave épreuve pour la République de Weimar. Le Reichswehr, limité par les conditions du traité de Versailles et confronté à une forte instabilité politique intérieure, se révéla incapable de réagir efficacement. En novembre de cette même année, face à la tentative de putsch d’extrême droite en Bavière — le fameux « putsch de la brasserie » (Beerhallputsch) — le président Friedrich Ebert confia des pouvoirs d’exception au ministre de la Défense Otto Gessler. Cette décision conféra au Reichswehr un rôle politique direct, marquant son évolution d’une force purement défensive à un instrument de stabilisation interne du régime.
Avec la signature des accords de Locarno en 1925 et l’entrée de l’Allemagne dans la Société des Nations, la Rhénanie fut démilitarisée. Jusqu’en 1930, l’influence du Reichswehr grandit, sur fond d’effondrement du parlementarisme et de gouvernance par décrets présidentiels. Franz von Papen et le général Kurt von Schleicher envisagèrent même d’utiliser l’armée pour renverser la République de Weimar.
En 1935, le Reichswehr fut officiellement dissous. Le régime nazi entama alors une vaste réorganisation militaire en violation directe du traité de Versailles. Le 1er mars, la Luftwaffe fut instituée comme force aérienne, et le 16 mars, la conscription fut rétablie. Ce même jour, le Reichswehr fut rebaptisé Wehrmacht.
Évolution du camouflage militaire allemand
À la fin de la Première Guerre mondiale, il est devenu évident que la couleur uniforme traditionnelle feldgrau (gris-vert) ne répondait plus aux exigences des conflits modernes. Dès 1918, les premières directives furent émises pour appliquer un camouflage tricolore sur le matériel militaire. Le 12 mai 1920, le commandement de l’armée (Heeresleitung) introduisit un nouveau schéma multicolore appelé en allemand Buntfarbenanstrichvert, de jaune et de brun. À l’origine appliqué à la main, il fut progressivement pulvérisé pour un rendu plus homogène et rapide.
Selon le bulletin officiel H.V.Bl. 1922, n° 24, ce type de camouflage devait être réservé aux véhicules de combat comme les blindés et les tracteurs d’artillerie. Les autres véhicules motorisés continuaient à être peints dans le feldgrau classique. Le Buntfarbenanstrich resta en usage au début de l’ère de la Wehrmacht, bien que les motifs aient varié en fonction des fabricants, des périodes ou des modèles. Malgré ces variations, ce camouflage tricolore est devenu emblématique et marque une étape importante dans l’évolution des techniques de camouflage militaire allemandes de l’entre-deux-guerres.
Normes de couleur dans l’armée allemande
Le 23 avril 1925, l’Allemagne créa le RAL — Comité d’État pour les conditions de livraison (Reichsausschuss für Lieferbedingungen). Officiellement rattaché au ministère de l’Économie, il fonctionnait comme un organisme indépendant. Son objectif principal était de normaliser les spécifications techniques des produits, notamment en établissant un système cohérent de couleurs pour l’industrie, les transports et les forces armées.
La première nomenclature officielle fut publiée en 1927 : il s’agissait du standard RAL 840. Ce système permit d’unifier la production de peintures et de réduire les coûts grâce aux achats centralisés et à l’élimination des doublons. À cette époque, l’importation de pigments était limitée en raison d’un manque de devises étrangères et de la faible valeur du mark à l’international. On privilégia donc les pigments produits localement. Dans les années qui suivirent, la palette fut élargie progressivement, surtout pour répondre aux besoins spécifiques de diverses administrations comme la poste, les chemins de fer ou d’autres services publics.
La même année, un standard distinct pour le secteur des transports fut introduit : le RAL 840 B, qui comptait 40 teintes adaptées aux véhicules. En 1932, ce standard fut mis à jour et renommé RAL 840 B2 pour éviter toute confusion avec l’édition précédente. Par la suite, de nouvelles couleurs furent ajoutées par le biais de feuillets complémentaires appelés Ergänzungsblätter.